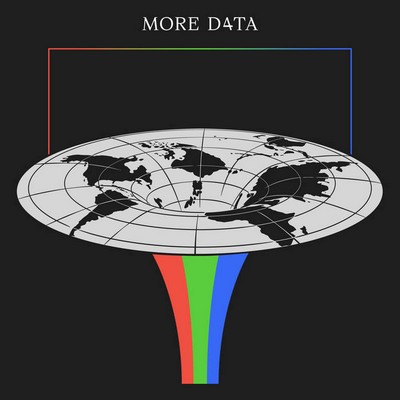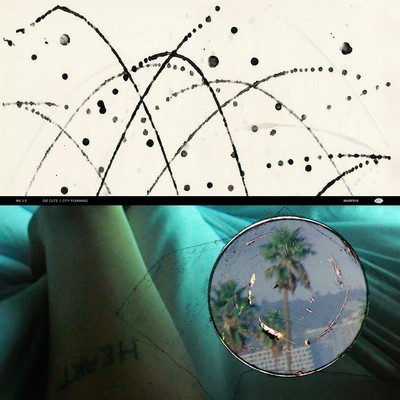Oliver Sim
Hideous Bastard
Oliver Sim a beau être la voix la plus reconnaissable du trio The xx, il en est sans doute aussi le visage le moins familier. Et si cela fait déjà quelques années que Jamie et Romy tentent d’agiter les foules de leur côté – cette dernière plus récemment en étroite collaboration avec Fred Again… —, Oliver aura davantage pris son temps avant d’explorer ses talents en solo. En 35 minutes chrono – et sous une pochette qui met un tantinet mal à l’aise —, on le retrouve en train de décaper les recoins sombres de ses jeunes années, évoquant crûment la prise de conscience de sa séropositivité, son rapport conflictuel au corps ou des relations aux conséquences dévastatrices. Beaucoup moins intéressé par les dancefloors que ses acolytes, Sim joue la retenue avec une pop électronique qui tempère à peine la noirceur de ses propos. C’est élégant (comme The xx), parfois un poil ennuyeux (comme The xx) et produit impeccablement (littéralement comme The xx puisque c’est Jamie qui s’y colle). Tous les morceaux de ce Hideous Bastard n’atteignent pas l’état de grâce (nous en avons déjà oublié une poignée) mais certains méritent à eux seul de poser l’album sur une platine régulièrement ("Hideous", "Never Here" ou encore "Fruit").
Morceau de choix : www.youtube.com/watch