2008-2013 : le goût des autres
Chronique par Bester Langs
Chien de garde bien intentionné et big boss de Gonzaï
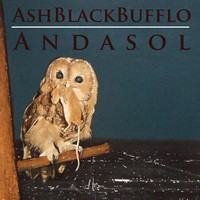
Ash Black Bufflo
Andasol
Lorsqu’on m’a demandé de sélectionner mon disque marquant des cinq dernières années, j’ai senti comme un vide s’installer en moi. Non pas que les bonnes sorties aient manqué ni que j’ai senti le manque d’inspiration s’installer en mon intérieur, mais l’exercice demandait une introspection, un honnête droit d’inventaire, afin de répondre à la grande question : quel disque de ces années là pourrais-je réécouter en 2020 sans avoir à rougir ? Après trois tours de la pièce et une visualisation mentale de tous ces disques qu’on a tant aimé la veille et dont on se souviendra difficilement demain , le « Andasol » d’Ash Black Bufflo m’a semble être un bon compromis entre le génie et la postérité.
Paru en 2011, c’est pas peu dire que ce disque n’a pas fait de vagues de ce coté de l’Atlantique. De l’autre coté, la notoriété de Jay Clarke semble cela dit tout aussi incertaine. Ce qu’on sait du barbu, c’est qu’il écrit des musiques de film – dont une a été primée au South By Southwest film festival et qu’il traine parfois ses guêtres aux cotés de groupes de Portland, des Dolorean à Holy Sons en passant par Grails. Dont l’histoire retiendra qu’ils sont les plus proches d’Ash Black Bufflo, d’un point de vue esthétique, musical et rigueur du contrepoint bordélique [ça ne veut évidemment rien dire, pas la peine d’ouvrir un dictionnaire].
Revenons à la question du début : pourquoi défendre « Andasol », disque à peine paru en import européen, et pas un disque des Strokes – quelle angoisse, un autre de Zola Jesus – nan sans rire – ou tout autre album sur lequel on s’est démesurément usé les oreilles et les poignets ? Et d’abord, à quoi reconnaît-on un grand disque ? Au fait qu’il ne ressemble à aucun autre, qu’il échappe aux raccourcis, aux poncifs, aux comparaisons, okay. Mais à quoi reconnaît-on un grand disque si on a grandi dans les années 70 ? Au fait que tout le monde s’en serait emparé pour siffler ses mélodies sur son lieu de travail, sans rougir. Très bien. Et donc, à quoi reconnaît-on un bon disque dans les années 2010 ? Au fait que personne d’autre que vous ne le connaît. C’est inévitablement le grand basculement du siècle et « Andasol » hérite de cette collante étiquette d’avant-garde alors que le même objet, autre époque, aurait certainement été porté aux nues, au moins dans les sections import des magazines ayant pignon sur rue.
Ayant écrit tout cela, « Andasol » compile en 18 morceaux aux longueurs variables l’esprit des Indiens et des terres rouges d’Amérique, le tout composé par un disciple d’Ennio Morricone ayant fait ses armes du côté de Tin Pan Alley. Instrumental de bout en bout, ne concédant aucune facilité, alternant clins d’œil à la musique minimaliste de Reich ou Glass (Misery is the Pilgrim’s pasture) et hautes envolées cinématographiques lorgnant vers des plans à la John Ford, « Andasol » est ce western contemporain en 16/9 qui laissera l’auditeur en état de choc. C’est au dessus du beau et toutes les raisons qui font de ce disque un chef d’œuvre indémodable ne tiendraient certainement pas dans trois tomes.
Précisément, que raconte ce disque ? Le quotidien d’une journée dans les plaines, l’ennui du cowboy et l’âpreté de son labeur, la difficulté d’exister quand on se trimballe un nom à la con comme Ash Black Bufflo et que votre disque sera dans le meilleur des cas écouté par une poignée de galeristes new-yorkais levant le petit doigt pour manifester leur contentement. Pourtant, qu’on ne s’y trompe pas. « Andasol » n’est pas un album réservé aux élites parquées dans leur loft à deux étages. C’est ici tout l’american dream qui s’invite en trame de fond, l’orchestre du Titanic qui vient jouer la partition du grand soir. Envoyez les violons et sortez les mouchoirs (Darkturnofmind), lustrez les bottes à éperons ou les arcs en bois (Buho), faites sauter le caisson du voisin de bureau pour qui Jay- Z représente l’apogée du songwriting ; à vrai dire une grande partie des disques parus ces cinq dernières années n’arrivent pas à la cheville d’ « Andasol » et les raisons de cette éclipse du superficiel tiennent sans doute au fait que la grande musique ici coloriée par des elfes du Colorado n’a pas vocation à être vendue ni marketée. A l’instar d’un Thomas Newman – à qui l’on doit plusieurs fantastiques B.O. dont celle d’American Beauty repiquée sur toutes les émissions pré-mâchées de M6 – Ash Black Bufflo compose des films qu’on ne voit pas, des opéras qu’on entend avec les mains, c’est un ode aux steppes, à la Monument Valley, à la richesse des panoramas de Yellowstone ; une œuvre qui chante l’immensité du continent, la solitude de l’être humain en panne d’essence sur la route 66 ; en bref un disque pour païen désireux d’accrocher un disque de chevet à la place du Christ supplicié.
A l’approche des années 2020, peut-être regardera-t-on en arrière pour contempler le chemin parcouru ; à ce moment là on reverra certainement cette grande barbe de druide portée par un Américain au nom ridicule, y’a de grandes chances pour qu’on soit aveuglé par toute cette splendeur d’ « Andasol ». Fantasia meets Il était une fois en Amérique.