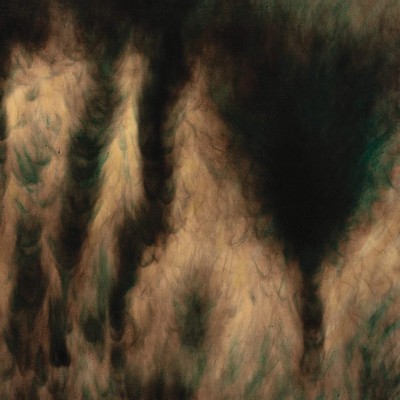Kevin Morby
Sundowner
À un moment de leur carrière, certains artistes produisent un album qui ne ressemble en rien à ce qu'ils ont fait auparavant. Quelque chose de plus fort, de plus expérimental, de plus sauvage; ou, dans le cas de Kevin Morby, quelque chose de plus paisible et introspectif. Il y a évidemment une histoire qui veut ça, celle du retour de l'artiste dans son Kansas natal, la maison qu'il y achète et l'album qu'il enregistre sur un 4 pistes dans la grange du fond du jardin. De ce parcours résulte Sundowner, disque plus apaisé, et peut-être mieux réfléchi que tout ce qui a pu paraître auparavant. Reste que ce sixième album (déjà le quatrième pour Dead Oceans) contient toujours toutes les meilleures caractéristiques qui font le sel et la beauté du songwriting de Kevin Morby, qui prouve une fois de plus son talent pour produire des mélodies brillantes et abouties, une musique touchante dans les sonorités comme dans le chant. Et puis il y a cette capacité de l'artiste de réussir à proposer un indie folk sobre, presque classique sans jamais devenir un pastiche grotesque d'une œuvre antérieure. Sundowner est un album simple pour des temps ô combien complexes et Kevin Morby, comme à son habitude, fournit le baume pour soigner les maux de tous ceux qui voudront bien l'écouter. (Quentin)
Morceau de choix : youtu.be/kdiusXx9nmY